
 |
||
Francontraste 2010
![]()
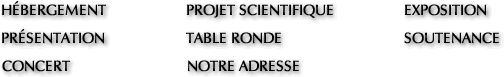
![]()
Vendredi 3 décembre 2010 à 17h00
Faculté des sciences humaines et sociales, Salle A-116
dans le cadre de la Section sciences du langage
présentation du livre: Linguistique, cognition et didactique
par Samir BAJRIĆ
Le contenu de cet ouvrage repose sur une conviction à la fois simple et ambitieuse : le phénomène langagier ne saurait s’inscrire en dehors de la dichotomie faits de langue / faits d’apprentissage. Les deux ensembles d’éléments renvoient respectivement aux traits spécifiques des langues et aux diverses difficultés qu’implique toute appropriation d’une langue donnée. Dans l’histoire des idées linguistiques, les linguistes se sont intéressés, de manière plus ou moins exclusive, à l’une des deux activités scientifiques : analyser les langues (linguistique théorique) ou décrire les problèmes que pose leur appropriation (linguistique appliquée). Or la discipline nommée linguistique-didactique livre aux sciences du langage une plus grande fécondité épistémologique dès lors qu’elle regroupe en un seul faisceau interprétatif structures des langues et structures cognitives du sujet parlant. Les concepts de néoténie, de vouloir-dire, de comportement linguistique, de langue in fieri, de subjectivité du locuteur et de silence des langues accentuent la nécessité de penser ensemble linguistique, cognition et appropriation des langues naturelles. Le monolinguisme y est défini comme une « fatalité » ontologique, dans la mesure où tout être normalement constitué et ayant dépassé le seuil fatidique qu’est l’âge linguistiquement adulte (10-12 ans) construit sa vision du monde à partir de cette même langue. Quiconque s’en approprie une autre procède immanquablement à des comparaisons. Ces dernières ajoutent à l’immanence de l’être une transcendance du sujet parlant à travers une seconde dichotomie : parler une langue / connaître une langue. Deux processus cognitifs définissant quantitativement et qualitativement les rapports entretenus avec toute langue que nous faisons nôtre.
Samir BAJRIĆ, Linguistique, cognition et didactique : principes et exercices de linguistique-didactique, Paris, PUPS, 2009, 302 p.
